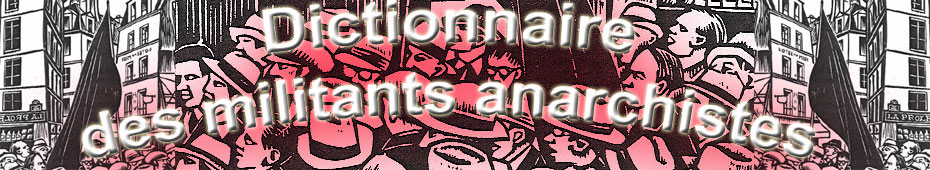José Gomariz naquit en 1920 à Fortuna, province de Murcie, dans une famille de paysans pauvres, d’un père, José Gomariz Lozano, qui travaillait comme palefrenier dans une exploitation agricole et qui mourut en 1926, à trente ans, des suites d’un coup de pied de cheval à l’estomac. Sa mère, Concepción Carreras, vingt-huit ans, se retrouva seule avec José, six ans, Juan, quatre ans, et enceinte de Ramón, qui naquit quatre mois après la mort du père. En 1929, elle décida de s’installer à Barcelone.
José travaillait déjà car il n’avait fréquenté l’école qu’un an. Il rencontra dans le bar où il aidait au service un militant anarchiste qui lui fit découvrir les textes de Bakounine, Voline et Kropotkine. À treize ans, il adhéra aux Juventudes Libertarias (FIJL).
Quand la guerre éclata, en juillet 1936, il habitait à Vic mais revint à Barcelone pour combattre et voulut s’engager dans les milices anarchistes, mais on le lui refusa à cause de son âge. Il trafiqua alors ses papiers et s’engagea au POUM, dans la 17e brigade, avec laquelle il combattit jusqu’aux événements de mai 1937 à Barcelone.
De cet épisode, lui resta une profonde haine envers le stalinisme. Il rejoignit ensuite l’armée populaire. Lors de la dernière bataille à laquelle il participa, le 8 février 1939, il fut blessé par des éclats d’obus. Il fut évacué par le dernier train sanitaire qui franchit la frontière française.
Pris en charge par la Croix-Rouge internationale et hospitalisé à Lyon, il fut, dès sa guérison, en juin 1939, envoyé au camp du Barcarès. Il y contracta une pneumonie et guérit grâce à un autre interné, médecin. Quand la guerre contre l’Allemagne éclata, une loi autorisa les étrangers à s’engager dans l’armée française. C’est ce qu’il fit le 15 novembre 1939. Il fit la « drôle de guerre » puis la retraite avec son unité, qui dut rejoindre Limoges. José Gomariz voulait gagner l’Angleterre pour continuer le combat contre le nazisme ; il se dirigea vers Bordeaux. À Saint-Projet, en Charente, fin juin 1940, il tomba gravement malade et fut hospitalisé à La Rochefoucauld. Une religieuse entendit un officier allemand dire : « Celui-là, quand il sera guéri, nous nous occuperons de lui. » Elle le fit évader et l’envoya chez son frère, paysan à Moutardon. José y travailla aux champs.
En 1942, il fut convoqué par le service des réfugiés. Il ne s’y rendit pas et entra dans la clandestinité. Par ailleurs, il avait retrouvé la trace de sa mère et ses deux frères, qui avaient traversé les Pyrénées à pied en février 1939, d’abord internés dans un camp d’Eure-et-Loir. Transférés dans un camp de la zone libre sur ordre de Jean Moulin (Concepción était la femme de ménage de sa mère), ils en connaîtront quatre, jusqu’à Gurs, dont Concepción fut libérée en novembre 1943, après plus de quatre ans et demi d’internement. La famille se regroupa alors à Ruffec, en Charente.
En 1944, José Gomariz rejoignit le maquis Foch.
L’été 1944, il fut de tous les combats en Charente, avant de participer à la campagne sur le front de Royan-La Rochelle. Il fut démobilisé en août 1945.
De la guerre d’Espagne, il ne parlait que pour évoquer l’aspect révolutionnaire (il disait : « J’ai vécu la révolution espagnole, puis, après 1937, la guerre d’Espagne. »), les communes libres d’Aragon, la fraternité, son amitié avec un avocat, Francisco, qui lui fit lire beaucoup de textes anarchistes, ainsi que Les Misérables de Hugo et Germina de Zola, mais les combats qu’il avait vécus, il n’en disait rien. Sauf une anecdote sur la bataille de Teruel, le froid, les pieds enveloppés de bandages parce qu’il n’avait plus de chaussures et qu’un convoi ferroviaire de brodequins venant de Tchécoslovaquie était bloqué à la frontière, car les autorités françaises, pour cause de non-intervention, en interdisaient le passage.
Sur la Résistance, il était à peine plus loquace. Il détestait les « héros », trouvait qu’il n’y avait aucun titre de gloire à avoir tué, même un ennemi.
Après la guerre, il espéra un moment voir la fin du régime de Franco. Mais il comprit que les Alliés n’avaient aucune intention de s’en débarrasser. Il resta donc à Ruffec avec sa famille, commença à travailler comme carrossier et peintre en voitures, métier qu’il exerça jusqu’à sa retraite, en 1983. Il se maria en 1948 avec une Française, Claudette Pautiers, dix-huit ans. Quand, en 1949, de Gaulle proposa la nationalité française aux combattants étrangers de la Résistance, il demanda sa naturalisation et l’obtint. En 1951, sa mère mourut, le couple quitta Ruffec pour Paris en 1953, où naquit leur fille unique, Christine. Muni de sa carte d’identité française, José Gomariz retourna pour la première fois en Espagne en 1956. Le passage de la frontière fut une épreuve qui dura des heures. Il travailla dans un grand garage de la banlieue où il se lia d’amitié avec un ouvrier kabyle, Saïd. Quand la guerre d’Algérie éclata, il prit fait et cause pour le FLN. Dans la loge de concierge du XVIIe arrondissement où la famille habitait, des hommes se retrouvaient, des valises circulaient. Le 17 octobre 1961, Saïd disparut, sans doute mort comme un grand nombre de ses camarades. José Gomariz ne parla plus jamais de cette période.
Il abandonna dès lors tout militantisme. Malgré la pauvreté, il fit tout pour que sa fille poursuivît ses études jusqu’à un diplôme universitaire. Mai 68 lui redonna espoir, brièvement. Il suivit de près le combat pour les droits civiques aux États-Unis, la répression en Tchécoslovaquie, celle qui se poursuivait en Espagne. Le coup d’État au Chili, le 11 septembre 1973, le marqua beaucoup. Et puis il y eut la mort de Franco fin 1975, la bouteille de champagne enfin débouchée, et la déception devant la transition. Pour lui, justice n’a jamais été rendue aux combattants républicains. Il lisait beaucoup, la presse et des livres d’histoire contemporaine. Il descendit une dernière fois dans la rue en mai 1981, pour la victoire de la gauche. En 1984, naquit son unique petit-fils, Frédéric.
Ses convictions anarchistes ne l’avaient jamais quitté. Ainsi, il n’a jamais voulu monter son entreprise, refusant de devenir un patron. De même, son anticléricalisme demeurait virulent. Il haïssait les nationalismes comme toutes les formes de chauvinisme. Le fait que de nombreux ouvriers votaient Front national le consternait, lui, l’antifasciste, l’internationaliste, l’antiraciste qu’il est resté jusqu’au bout.
Lors de son décès en août 2010 la famille écrivit dans le faire part de décès de Libération : « il est resté fidèle à ces combats. Venceremos ! »