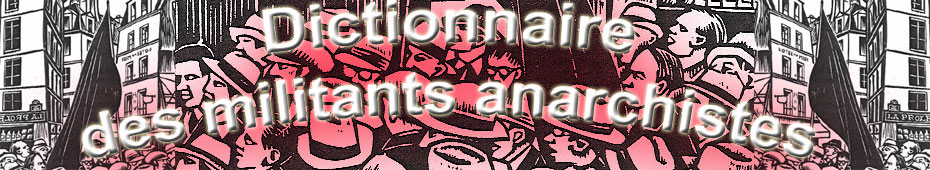A sa sortie du service militaire au 5e Régiment d’infanterie coloniale, G. Butaud avait été employé comme fumiste par son père, fabricant de poeles américains dans le XUUUème arrondissemet. C’est là qu’il avait commencé à fréquenter des compagnons révolutionnaires sur la Butte aux Cailles, ce qui lui avait valu d’être renvotyé par son père. Il s’était alors inscrit au groupe allemaniste du XIIIème. En 1893 il avait été l’imprimeur-gérant de la revue Le Message révolutionnaire du 13earrondissement qui n’eut qu’unn ou deux numéros.Puis il devint anarchiste et aurait publié, sous pseudonyme, fin 1894, la brochure La Société communiste future.
Après avoir participé début 1896 à une campagne abstentionniste dans le XIIIe arrondissement, Georges Butaud, né en Belgique de parents français (Pierre Alexandre et Clara Boitel), avait publié dès l’automne 1897 dans Le Père Peinard, un appel recensant les compagnons convaincus « de l’utilité de fonder une colonie anarchiste en France ». Il résidait alors à Paris, 4 Passage Boiton (XIIIe arr.).
En janvier 1897 il était à Trélazé et Angers pour des conférences notamment sur la répression en Espagne et y rencontrait de nombreux militants de la région dont Ménard, Bahonneau, Brion, Lelièvre, Legrall…etc.
En 1898 il fut signalé dans de nombreuses réunions publqiues et en novembre avait receuilli avec sa compagne Sophia, l’enfant de Francis Prost condamné suite à un article paru dans Le Crid de Révolte.
Venant de Genève, il arriva à Vienne (Isère) vers 1899 où il aurait travaillé (?) comme tailleur de pierre (selon d’autres sources il aurait été tailleur à la Comédie française).Avec sa compagne il résidait 6 quai Pajol.
Fin août — début septembre 1899 il avait accompli en tant que caporal réserviste, une période de 28 jours au 5erégiment à Cherbourg.
Selon un rapport de police du 25 octobre 1899, il avait fait une tournée d conférences à Romans et Bourg-de-Péage mais s’était montré très désilusionné, pensant « rencontrer de hommes d’action » et n’ayant « trouvé que des anarchistes politiciens à la remorque de Sébastien Faure ». A cette même époque et malgré les avis défavorables de Pierre Martin, il envisageaut de fonder une colonie agricole
Le 2 septembre 1901, lors d’une conférence organisée par la parti socilaiste, et suite à la violence de ses propos et à l’attaque des théories socialistes, il avait été expulsé de la salle du Cercle progressif des travailleurs où se tenait la réunion.
En 1900-1901, il avait été maintenu sur les listes d’anachiistes du département de l’Isère où il était qualifié de “très dangereux” et susceptible de faire de la propagnade par le fait. Selon la police, toute sa famille résidait à Biella (Italie).
Il fut le fondateur et gérant du Flambeau » organe des ennemis de l’autorité " paraissant à Vienne (n° 1, septembre 1901 — n° 13, 16 mars 1902) et imprimé par Ebrsold. Le 30 janvier 1902, suite à un article d’Antignac, intitulé « L’Assassin de Décembre » (voir portfolio), où ce dernier avait écrit que bien des malheurs auraient été évités si Napoléon III avait été assassiné, il avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Vienne (Isère) et condamné avec Antignac, qui n’avait pu se présenter au tribunal, à 15 jours de prison et 50 francs d’amende (cf. Le Libertaire, 8 février 1902). Au prononcement de la sentence Butaud s’était écrié « Vive l’anarchie ! » La peine avait été confirmée en appel à Grenoble en mars 1903. Butaud avait alors été écroué et placé à l’isolement le 17 octobre 1903 à la Mison d’arrêt de Château Thierry dont il sera libéré le 6 novembre.
Au printemps 1902 il était parti pour Paris, où il demeurait 1 Boulevard Davoust et avait participé à la campagne abstentionniste notamment aux cotés de Girault, Libertad et Louise Reville.
Selon un rapport de police d’avril 1903 il « était toujours armé » et qualifié de « très dangereux à surveiller étroitement ».
Butaud estimait que les colonies anarchistes, milieux libres, essais communautaires, constituaient des tentatives à encourager, car « si un certain nombre de producteurs pouvaient actuellement se réunir et vivre, dans le milieu bourgeois, de la vie communautaire, en laissant à chacun toute l’initiative, toute la liberté dont il doit disposer, ils fourniraient à tous leurs concitoyens un exemple frappant » (G. Butaud, L’Ouvrier des Deux-Mondes, 1er avril 1898).
Butaud lui-même tenta plusieurs essais et, en 1899, ce fut celui de la colonie de Saint-Symphorien-d’Ozon (Isère). Avec Zisly, Armand, et autres, il fut à l’origine de la constitution d’une société " pour la création et le développement d’un milieu libre en France " dans le but de " tenter une expérience de communisme libre”. Puis il fut un des animateurs du Milieu libre de Vaux, petite commune du canton d’Essomes-sur-Marne (Aisne) près de Château-Thierry, dont Henri Beylie était le secrétaire et trésorier. L’essai dura de 1902 à 1906. Butaud et sa compagne, Sophia Zaïkowska — il était marié à une autre Sophia (Kossowska ?) — s’y installèrent en mars 1903. Il aurait publié à cette époque un périodique intitulé L’Autarchie (Château-Thierry, paru ???) et se présentait comme le secrétaire du groupe de propagande végétalienne et développait les théories du crudivégétalisme. Lucien Descaves l’a ainsi présenté à cette époque : « garçon intarissable et joyeux, rouge de barbe et de cheveux », avec une « figure ardente de bon diable illuminateur », « L’homme qui ne croit pas aux miracles — et qui en fait ». En 1903 le milieu libre de Vaux comptait une dizaine de compagnons dont Antoine Leorat, Saulnier et Joseph Trebin (?). A cette époque Butaud se proposait à travailler comme comme tailleur d’habits.
G. Butaud et sa compagne quittèrent la colonie en avril 1904, puis y revinrent à l’automne. L’affaire fut liquidée en février 1907, tuée, écrivit Zisly, « par l’incohérence, le parasitisme, parfois l’imbécilité, aussi par l’estampage de certains soi-disant camarades » (cf. Le Libertaire, 24 février 1907).
Le 3 mai 1904 il avait à nouveau été écroué pour y subir la contrainte par corps de son ancienne condamnation à Grenoble.
G. Butaud participa, avec notamment Trimel, à un nouvel essai à Saint-Maur (Seine), 59 bis, quai de la Pie, où il s’installa en avril 1913. On s’y adonnait à l’élevage, à l’agriculture, et la colonie comprenait aussi quelques ateliers. On y pratiquait la polygamie, mais, écrivait Zisly, cela « ne va point sans causer quelques aléas » (voir L’Unique, n° 32, juillet-août 1948). Henriette Tilly et Scott étaient également parmi les animateurs du Milieu libre de la Pie auquel participèrent aussi Grosset, Georges Renard, Belverge, Baudon et Lapierre entre autres. Selon un rapport de police daté de juin 1913, le milieu libre comptait une « vingtaine de compagnons et de nouvelles chambres doivent être aménagées pour recevoir de nouveaux compagnons. Ceux qui y habitent payent 18 francs par semaine, ils travaillent à Paris et rentrent le soir à la colonie… Butaud y dispose d’une presse au moyen de laquelle il imprime son journal La Vie Anarchiste, paraissant chaque quinzaine. ». La police ajoutait que divers membres de la colonie diffusaient une brochure rouge intitulée >i>En cas de guerre et que la colonie disposait d’une filiale dans le XXe arrondissement, appelée Le Nid et dont le responsable était Louis Roger. A cette même époque il avait été soupçonné par la police d’avoir hébergé Juules Bonnot. La colonie s’était désagrégée début 1915.
Lors des réunions publiques, il se montriat très critique du syndicalisme et avait notamment décaré lors d’une réunin du groupe anarchiste du XVème arronndissement en s’adressant au compagnon Courty : « Mais jamais avec votre syndicalisme nous ne réaliserons la société communiste, car nous tomberons d’une société bourgeoise dans une autre ».
Le 14 mars 1914, aux cotés de Mauricus, Thuilier et Courty, il avait été l’un des orateurs du meeting organisé 33 rue Blomet par le groupe anti-parlementaire du XVe arrondissement (voir Portfolio). Il y avait notamment déclaré : « Lorsqu’un individu vote, il abandonne ses droits aux mains de l’élu, or, si on considère que la plupart des électeurs se contentent de voter et ne s’occupent plus ensuite de leurs mandataires, on comprendra aisément que l’action de voter n’est autre chose qu’un acte de renoncement à être soi même. Ne votez donc pas, ne vous donnez pas, ne vous abandonnez pas aux parlementaires, parce que ceux ci font leurs affaires et non celles du peuple ».
Butaud était également membre fondateur du Groupe des mille communistes qui se réunissait 49 rue de Bretagne et dont faisaient entre autres partie Scott, Henriette Tilly, Maxime Masson, M. Lienard, Madeleine Pelletier et Leconte.

Pandant la guerre il resta avec sa compagne à Bascon.
Après la guerre de 1914-1918, Butaud pratiqua le végétalisme, collabora au Néo-naturien et relança avec sa copagne à la colonie de Bascon près Château-Thierry (Aisne) où en 1920 il avait fondé la “coopérative pour la mise en valeur des terres incultes”. Un baraquement assez vaste avait été construit, disposant de 5 hectares de terre où vivaient plusieurs individus, des femmes et des enfants dont un certain Brehammet, un réformé de guerre.
Le 1er avril 1923, il fonda à Paris le Foyer végétalien, appelé aussi Œuvre préventive des misères humaines. Le Foyer, situé 40 rue Mathis (19e arr), avec un sous-sol et deux étages reliés par un monte-charge, comprenait un dortoir de six lits, une bibliothèque et un réfectoire où étaient servis pour 2, 50 fr. des repas végétaliens. Des cours de physique-chimie, de français, d’espéranto et d’Ido, d’orateur, etc. y étaient donnés ainsi que des conférences. Le foyer, qui servait également de boite aux lettres à divers groupes anrchistes, fut, à la mort de Butaud, géré par des compagnons espagnols dont Enrique Guma, Jean Muñoz, Juan Torrens et Augustin Ronamy.
En 1924 il avait ouvert un nouveau foyer végétalien 3 rue Fodéré à Nice qui comptait une dizaine de lits et organisait conférences et cours d’espéranto. En novembre 1924 il avait commencé à publier à Vence (Alpes-Maritimes), où il tenait un café, le mensuel Le Végétalien (Vence, 1924-1925, puis Ermont, 1925-1929, au moins 20 numéros en 3 séries), tiré à un millier d’exemplaires et repris à Ermont par Sophie Zaikowska lorsque le couple s’y installa vers l’été 1925.

Le Semeur contre tous les tyrans du 10 mars 1926 annonça que G. Butaud venait de mourir à Ermont (Seine-et-Oise) le 26 février 1926, âgé de 57 ans. A la veille de sa mort, il avait encore le projet de fonder une colonie en Ariège pour laquelle Tricot avait promis son concours.
OEUVRE : Ce que j’entends par individualisme anarchiste, juin 1901, 27 p. — Essai d’étude du besoin (Bascon, 1903) — En collaboration avec S. Zaïkowska : Étude sur le travail, Bascon par Château-Thierry (Aisne), 1912, 8 p. — L’Individualisme anarchiste et sa pratique, Saint-Maur, 16 p. — Seigneur de Château-Thierry, Nogent-l’Artaud et autres lieux, et croquant de Bascon, 1908 ; — Le végétalisme (préf. du Dr Legrain) ; — L’individualisme conduit au Robinsonisme ; — En collaboration avec V. Lorenc et J. Laboulais Résumé de la doctrine végétalienne ; — En collaboration avec S.Zaïkowska Tu seras végétalien (1925 ?).